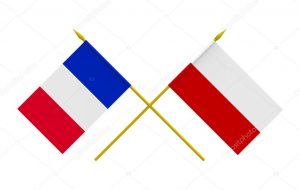 Au sein de l’Union européenne, les peuples sont censés partager des valeurs communes, une certaine vision politique et une volonté de coopération renforcée. Pourtant, lorsqu'on interroge un citoyen français sur la Pologne, force est de constater que ses connaissances restent souvent limitées : quelques clichés sur le froid, le catholicisme, voire des idées floues sur le « bloc de l’Est », Lech Wałęsa ou encore les « plombiers polonais »(1). Ce déficit culturel est d’autant plus étonnant que la Pologne, sixième pays le plus peuplé de l’UE, est un acteur de plus en plus incontournable de l’Europe contemporaine. Comment expliquer cette lacune ? Quelles sont ses origines ? Et pourquoi est-il essentiel d’y remédier ?
Au sein de l’Union européenne, les peuples sont censés partager des valeurs communes, une certaine vision politique et une volonté de coopération renforcée. Pourtant, lorsqu'on interroge un citoyen français sur la Pologne, force est de constater que ses connaissances restent souvent limitées : quelques clichés sur le froid, le catholicisme, voire des idées floues sur le « bloc de l’Est », Lech Wałęsa ou encore les « plombiers polonais »(1). Ce déficit culturel est d’autant plus étonnant que la Pologne, sixième pays le plus peuplé de l’UE, est un acteur de plus en plus incontournable de l’Europe contemporaine. Comment expliquer cette lacune ? Quelles sont ses origines ? Et pourquoi est-il essentiel d’y remédier ?
Une méconnaissance historique enracinée
L’histoire partagée entre la France et la Pologne est riche et ancienne. Dès le XIXe siècle, après les partitions successives qui firent disparaître la Pologne de la carte(2) de nombreuses élites polonaises (principalement intellectuels, artistes et militaires) trouvèrent refuge à Paris. Frédéric Chopin, Adam Mickiewicz ou encore Marie Curie contribuèrent significativement au patrimoine culturel et scientifique français. Sur le plan politique, Napoléon Bonaparte suscita de grands espoirs en créant le Duché de Varsovie (1807-1815), symbole fort de la volonté française d’appuyer la souveraineté polonaise.
Au XXe siècle, ces liens se sont poursuivis. Après la Première Guerre mondiale, l’immigration polonaise en France s’intensifie(3) entre 1919 et 1939, près de 500 000 Polonais s’installent principalement dans les régions minières du Nord et du Pas-de-Calais, attirés par la demande croissante de main-d’œuvre dans les mines et l’industrie. Cette communauté devient alors l’une des plus importantes immigrées de France à cette époque. On peut aussi rappeler la contribution notable de l’armée polonaise lors de la campagne de France en 1940.
Pourtant, cet héritage commun n’a pas suscité une curiosité profonde, du moins du côté français. Si les Polonais, par intérêt stratégique, économique ou culturel, ont toujours suivi attentivement les évolutions françaises, les Français ont souvent cantonné la Pologne à une périphérie floue de « l’Europe de l’Est ». Cette perception est renforcée par un enseignement scolaire qui aborde rarement l’histoire et la culture d’Europe centrale et orientale, à part à travers le prisme limité des deux guerres mondiales. Des périodes clés telles que la résistance au joug soviétique, les réformes post-1989 ou le rôle contemporain de la Pologne au sein de l’Union européenne restent largement absentes des manuels, contribuant à un déficit durable de compréhension mutuelle.
Une représentation stéréotypée et réductrice
La vision française de la Pologne reste souvent marquée par des clichés qui simplifient la réalité et en masquent la diversité.
La Pologne est ainsi souvent associée à une forte religiosité, marquée par un catholicisme conservateur et des valeurs traditionnelles. Cette perception a été renforcée par la période de gouvernement du PiS (2005–2007 puis 2015–2023), qui a mis en avant un discours politique et culturel centré sur ces thèmes. Elle est aussi régulièrement décrite à travers une réalité rurale et agricole, comme si les villages l’emportaient sur les villes modernes et dynamiques.
Le climat, présenté comme rigoureux, avec ses hivers longs et froids, contribue à forger l’image d’un pays « dur ». En France, les Polonais restent souvent associés à l’histoire de l’immigration ouvrière (mines, bâtiment, industrie), alors que la figure du « plombier polonais » s’est imposée comme cliché plus récent.
La cuisine polonaise est souvent réduite à des plats lourds et peu raffinés, riches en viandes, pommes de terre et choux, sans considération pour sa diversité gastronomique.
Certains clichés décrivent les Polonais comme un peuple fier, dur, parfois rustre, mais aussi chaleureux et hospitalier dans la sphère familiale.
Sur le plan politique, la Pologne est fréquemment perçue comme conservatrice, notamment sur les questions sociales, les droits des femmes et ceux des minorités, perception elle aussi accentuée par la période du PiS.
L’histoire du pays, marquée par les partitions, les guerres et le communisme, est souvent réduite à un passé douloureux, ce qui peut donner l’impression d’un pays figé dans la nostalgie. En France, s’ajoute aussi une perception controversée du rôle de la Pologne dans la Shoah, qui tend à occulter la complexité des débats historiques et mémoriels au sein même de la société polonaise.
Par ailleurs, la Pologne reste perçue comme un pays situé « à l’Est », qui reste culturellement éloigné de l’Europe occidentale, ce qui accentue une certaine distance. Enfin, la langue polonaise est souvent perçue comme difficile à comprendre ou à prononcer, renforçant l’idée d’une culture fermée ou complexe.
Ces représentations, parfois biaisées, limitent la compréhension de la Pologne contemporaine. Elles traduisent moins une réalité polonaise qu’un regard occidental qui, en hiérarchisant implicitement les cultures européennes, freine la construction d’un dialogue interculturel plus équilibré.
Une fracture médiatique et linguistique
Un autre obstacle majeur à la compréhension de la Pologne par les Français tient au traitement médiatique. Les grands médias généralistes français lui consacrent peu de reportages ou d’analyses approfondies, sauf lors de crises ou de polémiques – jugements européens sur l’État de droit, manifestations contre l’IVG, tensions avec Bruxelles, notamment durant la période du PiS. Ce cadrage donne une image partielle et souvent négative du pays. Cependant, depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, la Pologne apparaît davantage comme un acteur central de l’Europe, notamment par l’ampleur de son soutien militaire et humanitaire. Cette visibilité nouvelle contribue à nuancer sa perception en France : le pays est perçu comme moins exclusivement aligné sur les États-Unis et davantage comme un pilier régional incontournable. Néanmoins, ce traitement médiatique, souvent ponctuel et centré sur des moments de crise, reste insuffisant pour saisir la complexité des dynamiques sociales, culturelles et politiques polonaises.
S’ajoute à cela la barrière linguistique : le polonais, langue slave au système grammatical complexe, est peu enseigné en France. Les traductions de littérature polonaise contemporaine sont rares, même si des auteurs comme Olga Tokarczuk (prix Nobel de littérature 2018) contribuent à changer la donne. De fait, les Français accèdent à très peu de contenu polonais en version originale ou même traduit, ce qui renforce la distance.
Une culture pourtant foisonnante
La Pologne constitue un vivier artistique et intellectuel d’une grande richesse : son patrimoine architectural (de Cracovie à Gdańsk), son cinéma (de Wajda à Pawlikowski, en passant par Kieślowski ou Holland), sa littérature (Szymborska, Mickiewicz, Lem, Miłosz, Gombrowicz), ainsi que son théâtre (Grotowski, Kantor) et sa scène musicale contemporaine bénéficient tous d’une reconnaissance internationale.
Pourtant, cette présence demeure fragmentaire en France et repose largement sur la médiation culturelle, notamment la traduction littéraire, encore trop limitée.
Une diaspora polonaise ignorée
La France abrite pourtant l’une des plus importantes diasporas polonaises d’Europe de l’Ouest. Depuis les grandes migrations du début du XXe siècle, plusieurs millions de personnes d’origine polonaise ont contribué à l’essor industriel, social et culturel de la France en particulier dans les bassins miniers du Nord et de Lorraine. Pourtant, cette présence est restée largement invisibilisée ou réduite à un folklore (fêtes, costumes traditionnels), sans véritable reconnaissance de son apport dans l’histoire nationale.
Contrairement à d’autres diasporas plus visibles dans l’espace public, les « Français d’origine polonaise » sont rarement identifiés comme tels, même lorsque leurs trajectoires individuelles ont marqué la vie culturelle, politique ou économique du pays. Ce relatif effacement explique en partie la faible place de la Pologne dans l’imaginaire collectif français : le pays est perçu comme extérieur, alors même qu’une partie de son histoire et de sa population est profondément ancrée en France.
Des ponts à construire
Plusieurs pistes pourraient être envisagées pour renforcer la présence de la Pologne dans l’espace culturel français. Un premier axe consisterait à accorder une place plus importante à l’histoire et à la culture de l’Europe centrale dans les programmes scolaires, afin de mieux faire connaître une région souvent méconnue. Le soutien à la traduction et à la diffusion de la littérature polonaise, qu’elle soit classique ou contemporaine, représenterait également un levier majeur de rapprochement.
Par ailleurs, le développement de co-productions artistiques et audio-visuelles, notamment dans le cadre de partenariats avec des chaînes comme Arte, offrirait une visibilité accrue aux créations polonaises. De tels accords ont déjà existé avec la télévision publique polonaise (TVP), même s’ils ont parfois été suspendus pour des raisons politiques, montrant à quel point la coopération culturelle est sensible aux contextes nationaux.
Enfin, l’organisation d’événements culturels croisés permettrait de valoriser la diversité et la vitalité des deux scènes culturelles. Si la dernière grande saison culturelle France-Pologne (Nova Polska) a eu lieu en 2004, d’autres initiatives récentes, comme le festival KINOPOLSKA 2025, témoignent d’une volonté de poursuivre ces échanges. Ces actions restent toutefois ponctuelles et insuffisantes pour combler le déficit culturel et permettre une meilleure connaissance de la Pologne en France.
Le déficit culturel des Français à l’égard de la Pologne n’est pas un simple oubli ; il révèle des rapports asymétriques entre les cultures au sein même de l’Europe. Dans un monde où les replis identitaires menacent la cohésion du projet européen, il est impératif de rééquilibrer la représentation des pays encore parfois perçus comme « périphériques » alors qu’ils sont le « cœur » de l’Europe. Redécouvrir la Pologne, dans toute sa richesse et sa complexité, c’est aussi élargir l’horizon de notre compréhension du monde. C’est faire un pas vers une Europe réellement plurielle, solidaire et consciente de ses diversités internes.
Notes :
(1) Le « plombier polonais » est une expression popularisée en France au printemps 2005 lors du débat sur le projet de Traité constitutionnel européen.
(2) Les partitions de la Pologne désignent le processus par lequel le royaume de Pologne (officiellement la République des Deux Nations, union de la Pologne et de la Lituanie) a été démantelé à la fin du XVIIIe siècle par les trois puissants voisins, la Prusse, l’Autriche et la Russie. Il y a eu trois partitions principales (1772, 1793 et 1795).
(3) Dans les années 1890, une immigration ouvrière polonaise se développe en France. À la fin du XIXe siècle, près de 10 000 Polonais travaillent dans les mines et l’industrie, notamment dans le Nord et l’Est.
Bibliographie :
Danièle Cordiez, Les Polonais en France. Immigrés et travailleurs, Presses Universitaires du Septentrion, 1995.
Agnieszka Kowalska, « La Pologne dans les médias français : stéréotypes et réalités », Revue Européenne des Migrations Internationales, 2019.
Jerzy Kusiak, La Pologne et la France au XIXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
Sandy Paskiewicz, L'enseignement et l'apprentissage du français en Pologne et du polonais en France de 1989 à 2017 : approche comparée. Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2021.
Lien vers la version anglaise de l'article
* Sandy Paskiewicz a soutenu en 2021 une thèse de doctorat portant sur L’enseignement du français en Pologne et du polonais en France entre 1989 et 2017 (sous la direction de Stanisław Fiszer, université de Lorraine).
Pour citer cet article : Sandy PASKIEWICZ (2025), « La Pologne au-delà des clichés: un voisin européen oublié des Français », Regard sur l'Est, 29 septembre.
