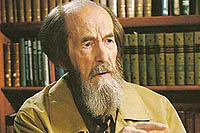 Il ne s’agit pas ici d’apporter un énième commentaire, ni même de tenter une synthèse des précédents, mais de comprendre cet ouvrage dans la perspective des relations complexes entre l’Est et l’Ouest, des années 1970 à nos jours.
Il ne s’agit pas ici d’apporter un énième commentaire, ni même de tenter une synthèse des précédents, mais de comprendre cet ouvrage dans la perspective des relations complexes entre l’Est et l’Ouest, des années 1970 à nos jours.
Il convient tout d’abord de s’interroger sur l’aspect révolutionnaire de L’Archipel du goulag. Lorsqu’il fut traduit par les éditions du Seuil en 1974, l’ouvrage n’apportait a priori aucune révélation sur le système pénitentiaire soviétique. Pourtant, une analyse synchronique permet de mieux comprendre pourquoi l’œuvre a provoqué un tel séisme dans un monde divisé par la guerre froide. Dans un second temps, il s’agira de reconsidérer l’ouvrage dans une perspective diachronique afin de savoir s’il peut finalement être davantage considéré comme un élément de rupture ou de continuité entre les deux entités géographiques considérées.
Un ouvrage révolutionnaire
Lorsqu’il évoque le regard du monde occidental sur l’URSS avant l’édition de L’Archipel du Goulag, l’historien Michel Winock parle de « grand aveuglement »[1]. Dans cette perspective, l’œuvre peut être considérée comme un soleil qui éclaircirait les obscurités du système soviétique. La métaphore est intéressante mais elle doit être précisée. L’astre n’a pas éclairé toutes les zones d’ombre de la même façon. Chaque «planète» a finalement développé sa propre lecture de l’ouvrage.
Une révolution populaire
En seulement quelques mois, le premier tome de L’Archipel du Goulag est vendu en 500 000 exemplaires. Ce succès de librairie se poursuit avec les deux tomes suivants puisque l’ensemble de l’œuvre atteint un total d’un million deux cent mille exemplaires. On ne peut cependant pas juger de l’audience au seul regard de l’édition. Les écrits de Soljenitsyne provoquent une véritable onde de choc dans les médias écrits français et suscitent débats et polémiques entre les plus grands éditorialistes. Nous pouvons donc considérer sans trop exagérer que la grande majorité de la population occidentale a été informée de l’édition et du contenu de L’Archipel du Goulag. Une citation du Guardian, à l’occasion de l’édition anglaise de l’ouvrage, résume bien l’état d’esprit des journalistes politiques de cette époque : « Vivre aujourd’hui et ignorer cette œuvre, c’est être une sorte d’imbécile historique, passer à côté d’un aspect crucial de la conscience de l’époque »[2].
Une révolution intellectuelle
On oublie trop souvent que Bernard-Henry Levy et André Glucksmann ont fait leurs premières armes en s’exprimant sur L’Archipel du Goulag[3]. Le succès de cet ouvrage ne tient pas seulement à sa valeur intrinsèque ; il est aussi le produit de l’histoire et du charisme personnel d’Alexandre Soljenitsyne qui représente un nouvel archétype de l’intellectuel. Depuis l’apparition du rideau de fer, les clercs occidentaux avaient quelque peu oublié le devenir de leurs homologues à l’Est. Les risques bravés par l’homme et son manuscrit pour rejoindre l’Ouest n’ont pas laissé indifférent. Les intellectuels ont probablement ressenti un mélange de culpabilité et de fascination face à cet homme qui a risqué sa vie et celle de ses proches au nom de l’art de la vérité. Pierre Daix est l’un de ceux-là. Ancien déporté de Mauthausen, il refuse longtemps d’accepter la réalité des camps de concentration soviétiques malgré une vive polémique qui le mène des colonnes de l’hebdomadaire communiste Les Lettres françaises jusqu’au prétoire dans le cadre d’un procès qui l’oppose à Kravchenko. Pierre Daix n’hésite alors pas à expliquer que les camps soviétiques étaient des camps de rééducation modèles[4]. Il change pourtant d’avis quelques années plus tard en découvrant, grâce à Elsa Triolet, l’un des premiers ouvrages de Soljenitsyne, Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch. Il s’implique alors personnellement dans l’édition de ce livre en 1963 et devient le plus fervent défenseur de son auteur[5]. Dans une lettre au Magazine littéraire en 1974, il décrit l’auteur comme « la voix de ceux qui n’ont pas voix au chapitre […] surtout les millions de victimes de Staline, simples prisonniers de guerre rejetés et persécutés, déportés politiques, torturés avec ou sans procès »[6]. Devant l’audience et l’autorité rapidement acquise de Soljenitsyne, les intellectuels occidentaux ont donc été amenés à relativiser leurs certitudes historiques mais aussi leur rapport au pouvoir politique et à la liberté d’expression. Une forme d’identification est à l’œuvre à la lecture de L’Archipel du Goulag. Elle entraîne une mutation progressive du comportement des intellectuels français qui se réunissent autour de la figure du « dissident »[7]. C’est pourquoi, dans une optique assumée de contestation du pouvoir, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes et François Jacob invitent des dissidents des pays de l’Est à Paris le 21 juin 1977, tandis qu’à quelques kilomètres, Valéry Giscard d’Estaing reçoit à l’Elysée son homologue Leonid Brejnev. De même, il est indéniable que l’ouvrage de François Furet Penser la Révolution française[8] n’aurait pas été possible sans la lecture préalable de L’Archipel du Goulag. L’historien concède lui-même que l’ouvrage a participé à la démolition du « catéchisme révolutionnaire ». Dès lors, nous pouvons considérer que cet ouvrage dépasse largement son message intrinsèque. Il invite à relire le passé à la lumière d’une nouvelle vision du monde : c’est une véritable révolution scientifique.
Une révolution politique
Certes, l’édition de L’Archipel du Goulag n’est pas directement à l’origine d’un renversement du pouvoir institué, mais nous pouvons considérer qu’elle contribue à des bouleversements importants dans l’échiquier politique. En France par exemple, depuis 1972, le Parti Communiste français s’est allié à d’autres forces au sein de l’Union de la gauche conduite par François Mitterrand. Une telle alliance nécessite d’adopter une position commune sur plusieurs sujets sensibles qui pourraient faire l’objet d’un débat électoral. Or, ce qui devient en France, dès janvier 1974 (soit seulement quelques semaines avant l’élection présidentielle), « l’affaire Soljenitsyne », exacerbe les tensions. Avant même la sortie de l’ouvrage en français, l’organe de presse du PCF, L’Humanité, critique vertement l’ouvrage et son auteur, relayant ainsi la campagne de délation soviétique. Le 1er février 1974, le bureau du PCF s’exprime même directement en dénonçant les « professionnels de l’antisoviétisme ». En face, l’opposition ne se fait pas attendre pour dénoncer non seulement les crimes commis au nom du communisme, mais aussi leur négation par le PCF et la collaboration de toute la gauche française au sein de l’Union. Philippe Malaud, ministre de la Fonction publique en 1974, n’hésite pas, par exemple, à utiliser la polémique pour décrédibiliser les communistes français dans La Croix. Il ironise ainsi : « Le communisme à la française, ce sera bien de chez nous, rigolard, petit-bourgeois et arrangeant. Eh bien ! Non. Tout permet au contraire de croire que le communisme en France ce serait probablement pire qu’ailleurs »[9]. Face à ces critiques, François Mitterrand répond à la polémique le 11 février dans L’Unité, en s’étonnant « du coup de sang qui a donné la fièvre au Parti communiste au point de ranimer un vocabulaire que l’on imaginait jeté aux oubliettes ». La même semaine, il précise dans le Nouvel Observateur que « la liberté ne se négocie pas » et que « si l’anticommunisme est incompatible avec l’union de la gauche […] cela ne peut interdire la critique des positions théoriques et pratiques du Parti communiste ». En somme, le chef de l’Union de la gauche adopte une position consensuelle afin de ménager les susceptibilités. Le 13 février, l’ensemble du bureau exécutif du Parti Socialiste déclare : « Le Parti socialiste, fermement attaché en France à la politique d’union de la gauche et en Europe à la politique de détente, tient à rappeler que pour lui la liberté de création, d’expression, de publication est inséparable de la démocratie socialiste ». La dimension internationale est ici importante. Si l’œuvre de Soljenitsyne pose question aux communistes français dans le contexte particulier de l’Union de la gauche, la situation est similaire partout dans le monde. Dans son ouvrage sur L’histoire de l’Europe depuis 1945, l’historien anglo-saxon Tony Judt considère que l’édition du manuscrit de L’Archipel du Goulag constitue un moment symbolique dans l’histoire politique et sociale de l’Europe. Il identifie cette période comme un désenchantement du monde préparé de longue date mais qui, à ce moment précis, bénéficie d’une audience jamais égalée. Il convient dès lors de comprendre pourquoi.
Une lecture historico-mémorielle de l’œuvre
Dès le début de l’année 1974, le journal L’Humanité dénonce la thèse d’Alexandre Soljenitsyne d’une façon originale. Il ne réfute pas la véracité de ses propos mais lui reproche d’utiliser ces informations à des fins antisoviétiques. L’angle d’attaque est intéressant car, au-delà de la polémique, il détient une part de vérité. Au moment de sa sortie, le contenu de l’ouvrage n’est guère original. En revanche, c’est la forme et le contexte qui font le succès immédiat de l’auteur.
Le grand éblouissement
Le célèbre rapport Khrouchtchev de 1956 consacrait déjà quelques lignes aux dérives du système pénitentiaire soviétique mais, comme dans l’ensemble du dossier, le nouveau Premier secrétaire tendait à attribuer la responsabilité de ces excès à son prédécesseur. Dans un développement sur l’incompétence militaire de Staline, il rappelle par exemple que de « nombreux commandants périrent dans les camps et les prisons, et l'armée ne les revit jamais plus ». L’ouvrage de Soljenitsyne porte la critique bien plus loin puisqu’il se dégage des considérations individuelles pour s’intéresser au système en lui-même. C’est pourquoi le sous-titre du livre porte les dates de 1918-1956. Sa thèse consiste à démontrer que le système concentrationnaire soviétique n’est pas le fruit de la seule volonté stalinienne, mais qu’elle germait déjà dans les prémices léninistes.
Il est également possible de citer plusieurs dizaines d’ouvrages qui, avant 1974, avaient déjà dénoncé les camps du goulag. Si certains ont été édités avant la Seconde Guerre mondiale[10], la plupart paraissent au début des années 1950. En France, c’est le livre de Victor Kravchenko, J’ai choisi la liberté, qui connut le plus grand succès. Il provoque en 1949 l’un des plus retentissants procès de l'après-guerre. Attaqué dans plusieurs articles de la revue communiste Les Lettres françaises sur la véracité de ses propos, l’auteur décide d’attaquer le journal en justice pour diffamation. Il appelle alors à témoigner à la barre des anciens déportés, dont Margaret Buber-Neumann, d’abord incarcérée par Staline dans un camp au Kazakhstan avant d'être livrée aux SS en 1940 puis envoyée à Ravensbrück. La justice donne alors raison à Kravchenko, validant ainsi en quelque sorte une « vérité juridique » bien avant la première loi dite « mémorielle ».
La force du récit de Soljenitsyne repose en fait énormément sur le talent littéraire de son auteur, mais aussi sur la forme originale choisie au préalable. L’Archipel du Goulag n’est pas l’énième récit d’un rescapé tels qu’ils se multiplient dans le paysage éditorial ; C’est une véritable investigation littéraire, qui rassemble 227 témoignages mis en perspectives, lesquels offrent un tableau plus complet de la réalité concentrationnaire soviétique. De plus, le contexte est particulièrement favorable. Si, dans son article sur « Le grand aveuglement », Michel Winock identifie bien les causes de cette cécité générale de l’occident, il convient désormais de comprendre pourquoi les yeux se sont soudain ouverts.
D’une part, il faut évoquer le contexte politique français au sein duquel le communisme perd de son influence. Le capital de sympathie du « parti des fusillés » s’érode progressivement. C’est d’ailleurs une force politique tellement vacillante qu’à l’occasion des polémiques sur l’ouvrage de Soljenitsyne, Michel Rocard s’interroge publiquement sur l’intérêt pour le Parti socialiste de maintenir avec elle une alliance : « La nature du régime soviétique, les liens que le Parti communiste français conserve avec lui et le projet de société dont sont porteurs les communistes qui restent liés à Moscou posent aux forces socialistes de redoutables problèmes »[11].
D’autre part, il faut évoquer le contexte international. Malgré quelques signes de réchauffement, la guerre froide est omniprésente dans les relations entre l’Est et l’Ouest. Tony Judt montre bien à quel point l’anticommunisme pouvait paraître décalé jusqu’au milieu des années 1970 tant cette idéologie semblait répondre à un idéal de progrès plus ou moins imité par les démocraties sociales occidentales. Or, lorsque paraît le premier tome de L’Archipel du Goulag, les pays industrialisés commencent à ressentir les effets du premier choc pétrolier. Les démocraties occidentales n’ont plus les moyens de financer leurs modèles sociaux et, au-delà des divergences idéologiques, ce sont désormais deux modèles de sociétés qui s’affrontent. Le PCF utilise d’ailleurs cet argument contre un livre qu’il considère comme un instrument de l’Ouest pour « détourner l’attention de la crise qui sévit dans les pays capitalistes ». L’Archipel du Goulag est donc un objet original qui s’inscrit progressivement dans l’histoire dont il propose une nouvelle lecture. Du statut de témoignage, il évolue vers un objet de dissension, voire de rupture entre l’Est et l’Ouest.
Les zones d'ombre de Soljenitsyne
Alors que l’ouvrage fascine les intellectuels occidentaux, dès février 1974, Soljenitsyne est déchu de sa nationalité et expulsé d’URSS. Il est alors contraint de s’installer à l’Ouest. C’est à partir de ce moment qu’il faut reconsidérer une œuvre que l’auteur prend parfois le temps de venir présenter dans des émissions de télévisions telles qu’Apostrophes ou encore Bouillon de Culture[12]. Les lecteurs français découvrent alors un nouveau Soljenitsyne, à partir duquel a été façonné le modèle du dissident mais qui s’avère être en fait profondément attaché à la Russie. En 1970 déjà, il a refusé de se rendre en Suède pour recevoir son prix Nobel de littérature, de peur que les autorités soviétiques ne le laissent pas revenir dans son pays. L’incompréhension des commentateurs occidentaux s’exprime par exemple dans la voix d’un journaliste qui s’étonne qu’à l’occasion de son passage en France en 1975, Soljenitsyne « a visité tout ce qu’il y a de russe dans Paris, réveillonnant même dans un restaurant… russe »[13]. L’écrivain lui-même entretient cette image puisqu’il justifie son déplacement par une volonté de rencontrer d’autres Russes qui s’installent, selon lui, « en France, comme nulle part en Europe ».
Alexandre Soljenitsyne se détache alors peu à peu du message que son œuvre semblait avoir porté en le précédant à l’Ouest. S’il condamne fermement les dérives du communisme, il refuse d’abandonner définitivement son pays. Lors de son passage à Paris, il affirme : « Je vis ici avec l’idée permanente que je ne fais que passer provisoirement ; je suis persuadé qu’un jour je retournerai en Union soviétique, dans ma patrie, mais je ne peux pas dire quand et personne ne peut le dire à ma place ». Il refuse par ailleurs d’être instrumentalisé par les pouvoirs politiques qui voudraient voir dans son exil une apologie des démocraties libérales. Ainsi, lorsque Jean d’Ormesson l’interroge sur son sentiment face à l’Occident au cours de l’émission Apostrophes du 11 avril 1975, l’auteur russe répond par une pirouette. Il explique que les menaces qui pèsent sur le travail de l’écrivain sont de natures différentes mais de valeur égale à l’Est et à l’Ouest : en URSS, il s’agit de la censure ; en occident, ce sont les médias. Au micro de Bernard Pivot en 1998, Soljenitsyne justifie d’ailleurs son départ de l’Europe pour le Vermont aux Etats-Unis par une volonté de fuir les sollicitations trop nombreuses et pour travailler plus sereinement. Dans d’autres interventions, comme dans l’émission Les dossiers de l’écran en mars 1976, il n’hésite d’ailleurs pas à se faire beaucoup plus critique en identifiant une « crise spirituelle » d’un Occident dévoué au matérialisme depuis le haut Moyen-âge.
Une oeuvre devenue universelle
Dès lors, il est plus aisé de comprendre le retour tant attendu de cet intellectuel qui, s’il a fasciné ses homologues occidentaux, n’a jamais perdu l’attachement spirituel pour sa patrie. Même en exil, Alexandre Soljenitsyne est resté un écrivain russe, défendant des valeurs russes. L’auteur de L’Archipel du Goulag peut finalement être considéré comme un formidable «passeur» culturel. Dans l’URSS soviétique, il était considéré comme un dissident car il osait dénoncer les failles du système soviétique. En Occident, il reconquiert progressivement sa citoyenneté, en devenant le meilleur défenseur de la Russie. Lorsqu’il revient sur le sol russe en 1994, il est finalement accueilli en héros.
Il est d’ailleurs surprenant de constater à quel point Soljenitsyne est toujours resté un acteur de premier ordre dans l’histoire de la Russie, malgré son éloignement géographique. En 1988, son œuvre peut encore être considérée comme un révélateur des évolutions en cours à l’Est. L’intelligentsia russe se réunit en effet au mois de décembre 1988 afin de célébrer le 70e anniversaire de l’écrivain ; deux mois plus tard, elle se réunit à nouveau afin de commémorer le 15e anniversaire de son expulsion, mais aussi pour demander aux autorités de lever l’interdit sur l’édition de son œuvre. En juin, Mikhaïl Gorbatchev annonce personnellement au cours d’une visite à Paris qu’il autorise la publication de L’Archipel du Goulag en URSS. Encore une fois, l’œuvre est placée au centre des évolutions politiques du pays : sa mise en vente dans les librairies russe devient un symbole de la «glasnost».
A son retour, il fait l’unanimité dans les médias. Pour les libéraux, Soljenitsyne incarne l’ouverture sur l’Occident, celui qui a su très tôt identifier les failles du système soviétique en se tournant vers l’Ouest ; pour les conservateurs, il est l’éternel promoteur des valeurs slaves à l’étranger. L’année 1990 est proclamée « année Soljenitsyne » par le rédacteur en chef de la revue russe Novy Mir : des colloques sont organisés sur son travail et l’ensemble de ses écrits est progressivement édité. Son rôle de passeur s’inverse alors de l’Ouest vers l’Est. Beaucoup de commentateurs ont tenté d’interpréter son choix de revenir en Russie par l’Est pour ensuite parcourir le pays en train jusqu’à Moscou : était-ce une volonté de revenir par un autre chemin que celui de l’expulsion ? Voulait-il simuler symboliquement un tour du monde ? Est-ce la métaphore d’une transition de l’Est vers l’Ouest ? Tant de questions auxquelles Alexandre Soljenitsyne n’a jamais vraiment répondu sauf pour rendre hommage aux victimes des camps du Goulag, essentiellement situés à l’Est du pays.
L’image de l’écrivain devient d’ailleurs ambiguë. Alors qu’il avait toujours habilement repoussé les questions politiques en Occident, il n’hésite plus désormais à prendre la parole dans ce domaine. Il se rend d’ailleurs à la Douma au mois de novembre 1994 afin d’y prononcer un discours où il affirme que « la Russie n’est pas démocratique. Elle est actuellement gouvernée par une oligarchie, un petit nombre de personnes corrompues et inefficaces ». C’est à cette même occasion qu’il explique regretter également la dissolution du vieil empire russe. Cette phrase malheureuse lui vaut de nombreuses critiques, tant à l’Est qu’à l’Ouest, où certains l’accusent de nourrir des sentiments nationalistes et d’être nostalgique du pouvoir tsariste. D’autres s’inquiètent de ses ferventes convictions religieuses orthodoxes. Les commentateurs s’aperçoivent en fait qu’après avoir vécu deux décennies au sein des démocraties occidentales, le champion de l’anticommunisme à l’Ouest n’est pas pour autant devenu le porte-parole de la démocratie à l’Est.
L’Archipel du Goulag est donc une œuvre monumentale. Si l’on retient souvent le choc qu’elle a suscité en Occident lors de sa parution, on oublie trop souvent que son apport ne se résume pas seulement à son intérêt informatif et qu’il dépasse largement ce cadre géographique. L’historiographie occidentale lui a quasiment donné la valeur d’un document patrimonial, regroupant ainsi des finalités culturelles et pédagogiques. Des extraits de l’ouvrage sont d’ailleurs largement utilisés dans les manuels scolaires car ils permettent d’illustrer l’URSS à l’époque de Staline. Nous avons vu cependant que l’ouvrage ne peut pas être réduit à une simple critique interne du modèle soviétique. C’est une œuvre à vocation universelle qui interroge tout autant l’Est et l’Ouest, voire les relations dynamiques entre ces deux entités.
[1] Michel WINOCK, « Le grand aveuglement », in L’Histoire, n°247, octobre 2000, p. 46.
[2] Cité par Tony JUDT, Après-guerre, une histoire de l’Europe depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2007.
[3] André GLUCKSMANN, La Cuisinière et le Mangeur d'homme, Paris, Le Seuil, 1975 ; puis Les Maîtres penseurs, Paris, Grasset, 1977. Bernard-Henry LEVY, La Barbarie à visage humain, Paris, Grasset, 1977.
[4] Pierre DAIX, « Pierre Daix, matricule 59.807 à Mauthausen », in Les Lettres françaises, 1949.
[5] Pierre DAIX, Ce que je sais de Soljenitsyne, Paris, Le Seuil, 1974.
[6] « Soljenitsyne à l’ordre du jour », in Magazine Littéraire, n°86, mars 1974, p. 22.
[7] Sur ce point, l’analyse de François HOURMANT est probablement la plus complète : « Autour de la dissidence. L’intelligentsia française entre célébration et identification ennoblissante », in Revue Historique, n°297, 1997, p. 223-250.
[8] François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978.
[9] Propos recueillis et rassemblés dans L’Année politique, économique, sociale et diplomatique de la France, Paris, PUF, 1975.
[10] C’est le cas de l’écrivain communiste yougoslave Ante CILIGA, Au pays du grand mensonge, Paris, Gallimard, 1938.
[11] Op. Cit. note 9.
[12] Les archives audiovisuelles de ces apparitions télévisées sont disponibles sur le site de l’INA.
[13] Commentaires du présentateur du journal télévisé de 20h le 3 janvier 1975.
* Mickaël BERTRAND est historien, Université de Bourgogne.
 Retour en haut de page
Retour en haut de page